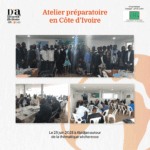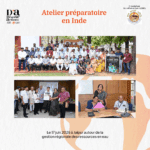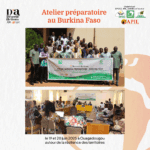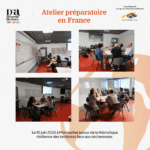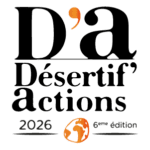Actu du 03/09/2025

L’ACDD (Association Citoyenneté et Développement Durable), WWF Afrique du Nord et l’IRA (Institut des Régions Arides )ont organisé un atelier le 18 et 19 juin en collaboration avec plusieurs partenaires dont le MEDD, l’OSS, des administrations régionales et des associations du Sud Tunisien.
Cet événement visait à rassembler les acteurs nationaux pour identifier les leviers de transformation des systèmes de production sédentaires en Tunisie afin de mieux résister aux sécheresses et à la dégradation des terres.
Un atelier pour faciliter les échanges et les travaux de groupe
Durant deux jours, une cinquantaine de participants ont mené des échanges et mis en commun une réflexion collective autour de la thématique « Transformation des systèmes de production sédentaires en Tunisie pour une meilleure résilience aux sécheresses et à la dégradation des terres ». Cet atelier a permis la capitalisation des expériences nationale de résilience face à la sécheresse et la prise de connaissances des travaux et dynamiques menés par les différents acteurs dans le domaine.
Les participants ont été divisés en deux groupes pour travailler en sous-atelier. Ce travail s’est étalé sur toute l’après-midi de la première journée et une grande partie de la matinée de la deuxième journée de l’atelier.
Des recommandations pour l’intervention en zones arides
Le premier groupe de travail a travaillé sur les adaptations techniques et technologiques pour une agriculture diversifiée et résiliente dans les régions arides tunisiennes.
Les participants ont identifié des recommandations articulées autour de huit axes stratégiques. Voici quelques exemples :
- Amélioration des techniques culturales dans les Oasis : Mettre en œuvre un modèle d’oasis à trois étages pour la diversification des cultures, appuyé par la recherche. Promouvoir les pratiques agroécologiques. Introduire des mécanisations adaptées (pollinisation semi-mécanique, drones, avions).
- Amélioration des techniques culturales dans l’agriculture pluviale : Contrôler l’introduction des espèces/variétés ; privilégier les variétés locales labellisées. Diversifier les cultures en sec (amandier, pistachier…). Encourager les multiplications locales de plants.
- Amélioration des techniques culturales dans l’agriculture irriguée : Évaluer la résilience des espèces introduites avant diffusion. Renforcer la diversité génétique locale. Généraliser les techniques d’irrigation localisée (ex. Chehtech avec eaux usées traitées).
- Ressources génétiques végétales : Identifier, conserver et valoriser les espèces locales les plus adaptées au stress hydrique et salin. Mener des programmes de sélection variétale adaptés aux conditions extrêmes. Encourager la labellisation des variétés locales.
- Ressources génétiques animales : Conserver et promouvoir les espèces animales locales, avec un suivi rigoureux des introductions. Renforcer les capacités de recherche et développement sur les races locales adaptées aux zones arides.
- Gestion de l’eau : Moderniser les systèmes d’irrigation via des technologies économes en eau (smart irrigation, multi-usage agriculture/pisciculture). Suivre les débits et quantités d’eau utilisées en particulier pour l’irrigation, ajuster aux besoins réels. Définir les besoins hydriques par culture pour une planification efficiente de l’irrigation.
- Gestion durable des sols : Enrichir les sols par l’usage du biochar, du compost issu des déchets oasiens et du rhizobium. Améliorer la rétention d’eau dans le sol par des pratiques comme le mulshing.
- Savoirs locaux et systèmes alimentaires : Inventorier, capitaliser et transmettre les savoirs traditionnels, notamment intergénérationnels. Valoriser les systèmes alimentaires ancestraux, intégrés et résilients.
- Innovation technologique : Produire des aliments pour le bétail à partir des sous-produits agricoles (valorisation circulaire). Mettre à jour les atlas des oasis et cartographier la désertification via la télédétection (SIG).
- Diffusion des bonnes pratiques : Valoriser les bonnes pratiques existantes. Identifier de nouvelles pratiques innovantes à partir des retours terrain. Renforcer le suivi de la sécheresse dans les zones marines à l’aide des technologies spatiales.
Le second groupe a travaillé sur la thématique de l’agroécologie et la restauration des écosystèmes dégradés. Les recommandations ont été organisées selon trois axes à savoir l’axe stratégique, l’axe opérationnel et l’axe financier. Voici quelques exemples :
- Axes stratégiques : Renforcer la politique de résilience à la sècheresse de la Tunisie grâce à l’intégration des stratégies de mise en œuvre des conventions issues de processus de Rio-92 et des ODD dans les politiques sectorielles et dans les plans de développement nationaux. Décliner les stratégies nationales d’adaptation aux changements climatiques et de résilience à la sécheresse au niveau des régions en adoptant une approche qui tient compte des spécificités territoriales ainsi que de la carte agricole actualisée et en mobilisant les moyens et compétences adéquats.
- Axes opérationnels : Elaborer des plans d’action de développement qui seront spécifiques et complémentaires aux différents accords multilatéraux ratifiées par la Tunisie. Elaborer des plans d’action territoriaux de la sécheresse . Renforcer les capacités au niveau territorial pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’action territoriaux de la sécheresse. Intégrer la mer en tant qu’écosystème qui subit les effets de la sècheresse sur la faune et la flore marines et le moyen de subsistance des populations insulaires.
- Axes Financiers : Allouer les moyens financiers nécessaires pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’action territoriaux de la sécheresse. Mobiliser les moyens et partenariats nécessaires au profit de cet enjeu national. Améliorer la résilience des agriculteurs et des communautés vulnérables face à la sècheresse en mobilisant les moyens nécessaires facilitant l’accès et l’application des nouvelles technologies
Retrouvez l’intégralité des recommandations dans le compte rendu complet de l’atelier.
Les écosystèmes du Sud Tunisien sensibles aux effets du changement climatique
Les travaux des sous ateliers ont été l’occasion de formuler des recommandations à destination des décideurs et de contribuer au plaidoyer de la société civile tunisienne dans le cadre de Désertif’Actions2026.
L’ensemble des échanges ont souligné une forte pression anthropique, au cours de ces dernières décennies, dans les écosystèmes du Sud Tunisien accentuant leurs sensibilités aux effets des changements climatiques et de la désertification.