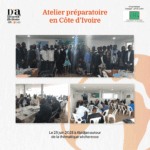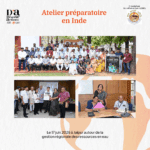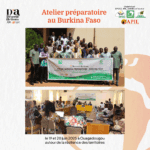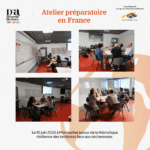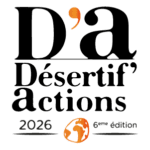Actu du 30/10/2025

Dans le cadre de la préparation du Sommet international Désertif’actions 2026, prévu du 25 au 28 mars 2026 à Djerba (Tunisie), l’Association El Argoub a organisé, le 16 septembre 2025, un atelier national sur la résilience face aux sécheresses en Algérie.
Cet atelier, qui s’est tenu en format hybride, depuis les locaux de l’association El Argoub à Laghouat, avec la participation d’intervenants à distance. Il a rassemblé une vingtaine d’acteurs issus du monde agricole, de la recherche, des institutions et de la société civile, afin d’identifier les leviers techniques, organisationnels et politiques pour renforcer la résilience du secteur agricole et pastoral face aux sécheresses de plus en plus fréquentes.
Un diagnostic partagé sur les vulnérabilités et les initiatives locales
Les échanges ont d’abord permis de dresser un état des lieux des actions déjà engagées sur le terrain, telles que :
- La promotion de l’irrigation rationnelle et de techniques innovantes pour économiser l’eau et améliorer la rétention hydrique des sols
- L’utilisation d’espèces rustiques et locales, mieux adaptées aux conditions arides
- La mise en place de bassins de retenue combinant fertigation et pisciculture
- La valorisation des sous-produits agricoles (déchets de palmeraies utilisés comme fourrage)
- La transhumance saisonnière, essentielle à la gestion durable des parcours steppiques
Des freins techniques, financiers et institutionnels identifiés
Les participants ont ensuite analysé les freins et leviers à la diffusion de ces initiatives.
Les principaux obstacles relevés concernent :
- L’accès limité aux technologies d’irrigation performantes et aux semences adaptées
- Des financements insuffisants et mal ciblés, notamment pour la petite agriculture
- Une gouvernance encore centralisée, freinant la prise en compte des réalités locales
- Un manque de coordination entre institutions, chercheurs et agriculteurs
Pour y répondre, plusieurs leviers ont été proposés :
- Décentraliser la gouvernance agricole
- Créer des mécanismes de financement dédiés aux petits exploitants
- Renforcer la vulgarisation et la formation
- Et promouvoir les technologies d’agriculture de précision (smart agriculture) pour mieux gérer la ressource en eau
Du constat à l’action : des propositions de plaidoyer structurées
Dans une dynamique participative, les participants ont élaboré des messages de plaidoyer à destination des décideurs publics, des bailleurs et des acteurs économiques.
Parmi les recommandations phares :
- Faciliter l’accès aux technologies d’irrigation et simplifier les procédures administratives pour les agriculteurs
- Impliquer systématiquement les producteurs dans l’élaboration des politiques agricoles
- Développer la recherche sur les semences résistantes à la sécheresse et les itinéraires techniques économes en eau
- Créer un calendrier agricole par écorégion, adapté aux spécificités climatiques du pays
- Mettre en place un fonds national pour l’innovation agricole locale
- Renforcer les programmes de formation et de vulgarisation sur les pratiques agroécologiques et climato-intelligentes
Ces messages convergent vers une approche intégrée, combinant innovation technologique, décentralisation institutionnelle et participation des acteurs de terrain.
Trois messages clés pour le plaidoyer national
Au terme des échanges, trois messages consensuels ont émergé :
- « L’eau est notre or bleu, notre héritage partagé – ne la laissons pas couler entre nos doigts ! », en prônantune utilisation rationnelle et technologique de l’eau.
- « Face au défi climatique, semons les graines de la résilience ! », en développant et favorisant des semences résistantes à la sécheresse.
- « Reverdir nos steppes, c’est assurer l’avenir de nos éleveurs ! », en restaurant et gérant durablement les parcours steppiques
Ces orientations illustrent la volonté collective de replacer la résilience agricole et pastorale au cœur des politiques nationales, dans un contexte où la désertification menace directement la sécurité alimentaire et la cohésion sociale.
Retrouvez l’intégralité des recommandations dans le compte rendu complet de l’atelier.